Les services de Vilavi sont confirmés comme services essentiels mais la pression augmente sur les équipes d’intervention.
Comme plus de quatre-vingt centres de traitement des dépendances au Québec*, le centre de Vilavi, situé dans la région de Terrebonne, doit faire face à des questions complexes face à la pandémie de la Covid-19 : les services doivent-ils être maintenus? Si oui dans quelles conditions? Avons-nous les moyens d’offrir un traitement de qualité tout en garantissant la sécurité des équipes et des usagers? Quelle est la brèche la plus critique, les employés qui circulent entre le centre d’hébergement et leurs foyers ou bien les nouveaux résidents qui sont admis?
Ces questions sont posées dans chaque centre du Québec avec des réponses variables en fonction des conditions d’un organisme à l’autre : réalité économique, soutien effectif du réseau public, nombre de lits, durée du traitement, conditions contractuelles, capacités physiques des bâtiments, intégration technologique etc… Toutes ces considérations aboutissent à une décision qui n’est valable que le temps de voir apparaitre de nouvelles contraintes.
L’équipe de Vilavi s’est efforcée de concevoir un « kit décisionnel » dynamique qui vise à répondre aux enjeux existants en se basant sur les informations rendues accessibles par ses différents réseaux : dépendances et santé mentale, itinérance, logement social et déficience intellectuelle.
Pour le centre de traitement, la décision a été de maintenir les services et les admissions car les personnes qui font appel à nous ne peuvent accéder à des solutions de remplacement et risque donc d’apparaitre rapidement dans le réseau hospitalier. Il faut noter que le CISSS de Lanaudière (CISSS-L) avait lui-même décidé le 16 mars de la suspension des admissions dans les Unités de Lits Multifonctionnels (ULM) opérée en collaboration avec Vilavi et le Pavillon du Nouveau Point de vue, avant de revenir le jour même sur cette directive. Le lendemain on nous confirmait l’intention du CISSS-L de « maintenir notre partenariat et notre collaboration pour la référence, le placement et l’admission de la clientèle en ULM au Nord et au Sud de Lanaudière ».
Quelles sont les implications du maintien des services?
Les retombées sont avant tout humaines, car la pandémie génère un grand nombre de craintes chez les employés et les usagers. Des mesures ont donc été mises en œuvre pour prévenir l’exposition au virus (lot de mesures définies par le Ministère de la Santé) et le tout a été largement communiqué aux employés et usagers pour obtenir leur adhésion et leur engagement dans la mise en place de ces mesures. Toutefois les demandes répétées pour obtenir des équipements de protection et des produits de désinfection ne sont toujours pas répondues par le gouvernement.
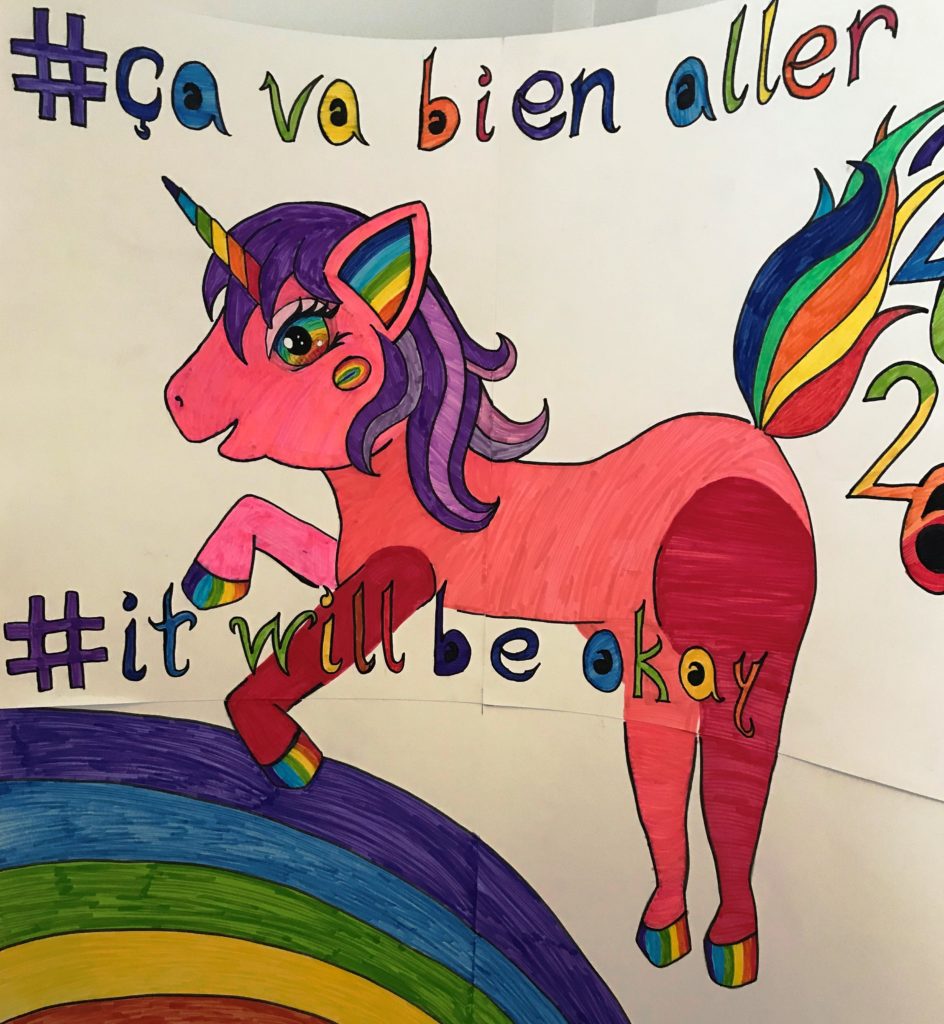
Les personnes non desservies peuvent-elles suspendre leur besoin de traitement ou bien vont elles apparaître dans un réseau de santé déjà saturé par la gestion de la crise?
Les effets sont aussi économiques: l’inquiétude a entrainé l’abandon du traitement par plusieurs résidents, le train de mesures de contrôle pré-admissions ralentie le flux d’entrées au centre et le résultat est une baisse nette de l’occupation, passant en 2 semaines de 34 à 26, puis 23 personnes le 23 mars. Une baisse de plus de 30% qui se répercute instantanément sur les revenus alors même que de nouvelles dépenses doivent être supportées par l’organisme, notamment l’achat d’équipements de protection et de produits d’hygiène, les coûts de concertation et le remplacement des employés en isolement.
La crise met en évidence la fragilité du modèle de financement
Pourtant cette baisse de 30% des revenus ne peut être accompagnée de la mise à pied de 30% des employés car l’inquiétude et la pression en temps de crise doit être compensée au contraire par l’expression de notre reconnaissance et de notre admiration pour l’engagement dont font preuve nos intervenants. De plus l’implantation des mesures de prévention et l’anxiété vécue par les usagers et leur entourage augmentent la charge de travail qui doit être assurée par des équipes qualifiées et aguerries aux contraintes de nos milieux de travail.
En réalité le modèle actuel repose essentiellement sur l’engagement social de tous les organismes en dépendances et de leurs employés, ce qui ne fait aucun sens du point de vue de la santé publique. Si nos organismes offrent des services essentiels en temps de crise, le modèle de financement ne peut reposer sur la fragile capacité de chaque centre à les maintenir!
Un cycle de téléréunions de concertation proposé par le regroupement national des centres de traitement en dépendances (l’AQCID) a permis de mettre en évidence la disparité des décisions. Plus de la moitié des centres ont suspendu leurs admissions, quelques centres ont fermé temporairement ou définitivement leurs portes et les mesures de distanciation entraîne à tout le moins une diminution de la capacité d’accueil. De plus, des centres publics auraient aussi fermé leurs services d’hébergement et réduit leurs services externes. Mais les personnes non desservies peuvent-elles suspendre leur besoin de traitement ou bien vont elles apparaître dans un réseau de santé déjà saturé par la gestion de la crise? À cette question l’AQCID apporte le point de vue suivant : « le contexte de pandémie exacerbe les besoins des personnes faisant l’usage de drogues. Le stress et l’anxiété, la précarité financière, l’accès plus difficile aux services sont autant de facteurs de risque justifiant la disponibilité et le bon fonctionnement des organismes communautaires ».
*On compte 85 centres et 2600 places de traitement avec hébergement au Québec.
Information : Bruno Ferrari, directeur général | info@vilavi.ca | 514-875-7013
